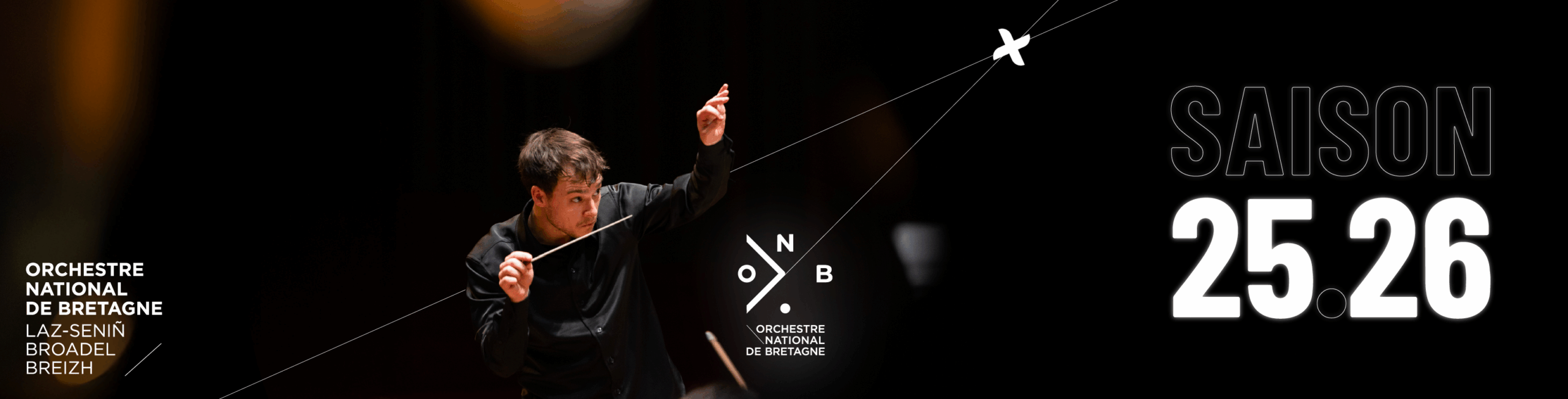Symphonie n°4 en ré mineur op.120 (version de 1841), Robert Schumann
Robert Schumann
(1810-1856)
Symphonie n°4 en ré mineur op.120 (version de 1841)
Quatre mouvements
I. Introduction – Allegro
II. Romance
III. Scherzo
IV. Finale
Date de composition : 1841
Date de création de la version de 1841 : 6 décembre 1841 par l’Orchestre du Gewandhaus de Leipzig sous la direction du violoniste et compositeur Ferdinand David.
La Symphonie en Ut Majeur, dite “La Grande” de Schubert joua un rôle considérable dans l’écriture symphonique de Schumann. En 1838, soit dix ans après la disparition de l’auteur de la Symphonie Inachevée, Schumann rendit visite au frère de Schubert, Ferdinand. Ce dernier lui montra les manuscrits en sa possession dont certains avaient été refusés par les éditeurs. Schumann comprit qu’il tenait dans ses mains plusieurs chefs-d’œuvre dont des pages inédites pour orchestre. La musique de Schubert eut un effet “déclencheur” chez Schumann qui se lança dans l’écriture pour orchestre. Il réagit dans l’enthousiasme de cette découverte et choisit de concentrer toute son énergie artistique sur le seul répertoire symphonique. Comme la plupart des musiciens de son époque, Schumann demeurait angoissé à l’idée de se lancer dans une telle aventure. Les symphonies de Haydn, Mozart et plus encore de Beethoven étaient considérés comme des univers incomparables, d’une telle perfection qu’il semblait pour le moins présomptueux de rivaliser avec ces chefs-d’œuvre.
En 1841, Schumann acheva sa Symphonie n°1 du “Printemps”, puis le triptyque Ouverture, Scherzo et finale, qui n’est en réalité qu’une symphonie de forme plus modeste. Ce que l’on oublie parfois aussi, c’est qu’il mit immédiatement en chantier une autre symphonie, en ré mineur. Celle qui est présentée comme étant la quatrième et dernière du cycle est par conséquent la seconde dans l’ordre chronologique des opus symphoniques de Schumann. Il dédia le manuscrit à Clara Schumann à l’occasion de son anniversaire, le 13 septembre 1841.
Si la Symphonie du Printemps connut un réel succès, huit mois plus tard, la Quatrième fut reçue assez tièdement par le public. Les harmonies rudes, la construction “révolutionnaire” dérangèrent les auditeurs. L’originalité était si grande que le compositeur se demanda s’il ne valait pas mieux appeler la nouvelle pièce : Symphonische-Phantasie. Après l’échec de la création, Schumann oublia la partition.
Il la redécouvrit en 1851 et il décida de la réécrire presque intégralement. La seconde exécution eut lieu à Düsseldorf en 1853. L’œuvre révèle une carrure qu’elle ne possédait pas dans la version originale, d’une fraîcheur sans pareil. C’est cette version que l’on entend ce soir.
La symphonie s’ouvre sur un mouvement Allegro, Ziemlich langsam – Lebhaft (Assez lent, animé) en ré mineur. Une partie du matériau thématique qui va tant surprendre le public et la critique, est issu d’une cellule unique. En effet, les cinq premières notes de l’Introduction lente et méditative prennent de multiples formes et directions. Dans un cadre formel strict et en apparence respecté, Schumann invente un nouveau traitement de la circulation des thèmes au sein de l’œuvre. Il annonce le principe du thème cyclique obsessionnel, précurseur du fatum si cher à Tchaïkovski dans ses trois dernières symphonies. Les mutations aboutissent à une amplification expressive qui introduit le développement Lebhaft du mouvement. L’énergie vitale que l’on perçoit est produite par le chevauchement de motifs secondaires. L’apothéose qui semblait conclure cette partie en mode majeur retourne subitement à la tonalité initiale, inquiétante, de ré mineur. Ce premier mouvement devint l’une des plus grandes sources d’inspiration de nombreux compositeurs du romantisme tardif.
La Romance – Ziemlich langsam – en la mineur qui suit, et dont le thème est énoncé au hautbois soutenu comme par un écho par les violoncelles, n’a pas oublié la cellule originelle de la symphonie. Son expression nostalgique et grave à la fois s’estompe progressivement dans une mélodie finement ornementée par le violon solo. Le thème de l’introduction ne tarde pas à réapparaître. Les couleurs du nocturne s’effacent progressivement pour laisser place au mouvement suivant, presque immédiatement enchaîné.
Le Scherzo – Lebhaft en ré mineur, l’une des pages les plus célèbres de Schumann, affirme avec force le motif de la destinée comme un hommage à Beethoven. Le rythme est tendu, simple et généreux. Il est marqué de manière volontairement rude. La liberté de ton trouve une habile transition avec le Trio dont le raffinement s’inscrit en totale opposition stylistique. La coda fait transition avec le finale.
Le Finale – Langsam, Lebhaft – dans la tonalité lumineuse de ré majeur et sans autre précision que celle “d’animé” rappelle dans la solennité de son introduction lente et grave, la Symphonie n°9 de Beethoven. Le climat mélancolique se mue petit à petit en un superbe élan dans la tonalité de ré majeur. Il évoque le thème du Larghetto de la Symphonie n°2 de Beethoven. Schumann choisit d’achever la partition dans l’optimisme le plus serein, d’une fougue héroïque, au tempo presto.
A Lire
« Robert Schumann » par Alain Duault (ed. Actes Sud / Classica, 2010