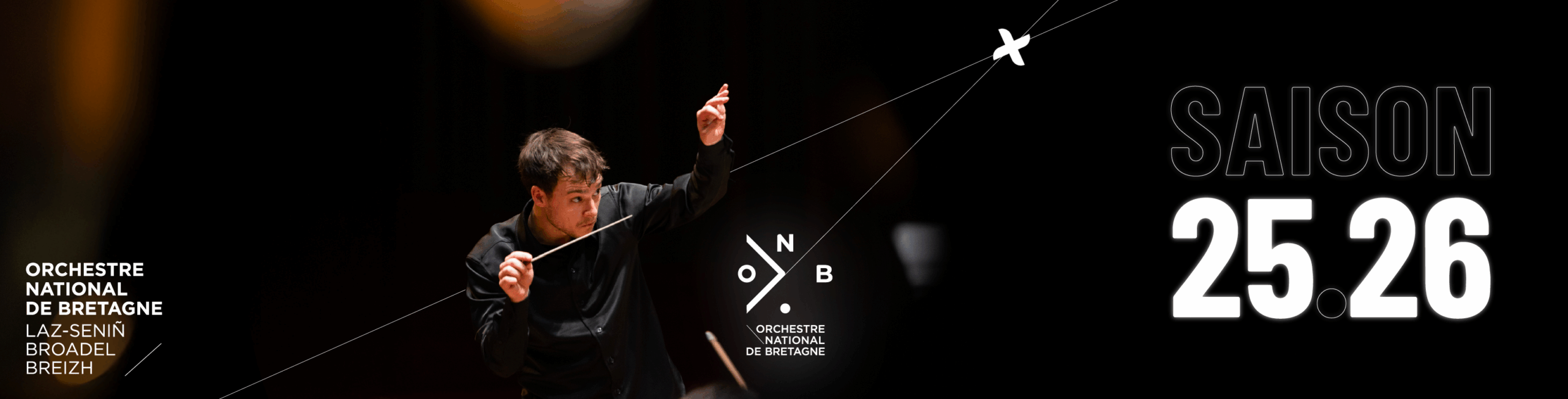Musique pour cordes, percussion et célesta – Bela Bartók
Bela Bartók
(1881-1945)
Musique pour cordes, percussion et célesta
- Andante tranquillo
- Allegro
- Adagio
- Finale (allegro molto)
Date de composition : Achèvement le 7 septembre 1936
Date de création : 21 janvier 1937 par l’Orchestre de chambre de Bâle dirigé par Paul Sacher.
7 septembre 1936. Bartok met un point final à l’une des partitions les plus extraordinaires du 20e siècle. Elle lui a été commandée par le chef d’orchestre et mécène Paul Sacher qui, l’année suivante, en assure la création.
Le titre de l’œuvre est étrange par son imprécision (“Musique”) et… sa précision (“pour cordes, percussion et célesta”) ! “Musique” définit un objet pur, sans contrainte esthétique comme s’il s’agissait d’une clé mathématique. La partition se compose de quatre formes correspondant à quatre mouvements : la fugue, la sonate, le palindrome (un groupe de mots ou de notes pouvant être lu en “miroir” sans que le sens en soit altéré) et le rondo.
Bartók emploie la fameuse “section d’or” dans ce qui apparaît comme un véritable jeu intellectuel. Rappelons que celle-ci était utilisée par les architectes de l’Antiquité. Elle consiste à diviser une distance, en l’occurrence une durée en deux, de telle manière que le rapport de la durée entière sur la section la plus longue soit égal au rapport de la section la plus longue sur la section la plus courte.
Quant à l’organisation rythmique et harmonique, elle s’avère aussi complexe que les grandes “arches” musicales… de Bach auxquelles elle rend indirectement hommage. Bartok s’impose des règles de construction d’autant plus rigoureuses que, paradoxalement, la liberté des interprètes s’avère immense. Les Quatrième et Cinquième quatuors à cordes datés de la même époque portent à un degré comparable, la perfection et l’émotion d’une écriture qui ne fera pas école.
Cet exemple unique dans l’histoire du 20e siècle (à l’exception toutefois de la Sonate pour deux pianos et percussions du même compositeur) ne fait allégeance à aucune esthétique.
La disposition de l’orchestre spécifiée dans la partition est particulièrement instructive. Les instruments à cordes sont divisés en deux groupes qui “encerclent” l’orchestre, les contrebasses étant dans le fond, le son “montant” du plus grave vers le plus aigu au fur et à mesure que l’on se rapproche du chef d’orchestre. Au centre du dispositif, on observe le groupe des percussions (deux tambours militaires avec et sans timbre, des cymbales, un tam-tam, une grosse caisse, des timbales) puis les claviers (célesta et xylophone) et enfin, sur le devant de la scène, le piano et la harpe. Cette dernière revêt d’ailleurs une importance considérable.
Qu’il nous soit permis une anecdote. Un collectionneur nous montra un jour une carte postale envoyée par Bartók à son éditeur, mentionnant le titre de l’œuvre : Musique pour cordes, harpe, percussion et célesta. Le mot “harpe”, sur le côté de la carte, fut en partie perforé par le système d’attache du classeur contenant le courrier… L’oubli dans le titre imprimé ne fut jamais corrigé !
Ce détail révèle, entre autres, l’extraordinaire difficulté d’organisation de l’œuvre. Bartók n’avait bien évidemment pas le souci d’une restitution sonore stéréophonique dont les premières expérimentations n’apparaîtraient que durant la Seconde Guerre mondiale. Mais l’élargissement des plans sonores, la localisation précise des instruments et par conséquent de leur dynamique est une donnée essentielle pour traduire la richesse stupéfiante de cette musique.
L’économie de l’instrumentation, celle d’un petit orchestre de chambre, accentue paradoxalement la violence expressive de l’œuvre, concentrée sur l’idée d’un “resserrement” de l’écriture. Le crescendo initial, par exemple, ne dépasse pas la quinte, mais cet ambitus restreint est suffisant pour donner l’impression d’une incantation païenne. Ce sont enfin des trouvailles stupéfiantes qui traversent toute l’œuvre comme l’emploi de glissandos aux timbales, de modes d’attaque spécifique à la harpe, aux cordes…
L’immense crescendo introductif (Andante tranquillo) développe une fugue lente aux cordes. L’entrée successive des voix aboutit à un sommet triple fff puis à une redescente avec le sujet de fugue inversé. Une telle introduction a été comparée au principe de “l’éventail” : les entrées paires du thème suivent en effet l’ordre des quintes supérieures et les entrées impaires celui des quintes inférieures. Cette partie de l’œuvre monothématique porte une tension extraordinaire dont la coda conclusive synthétise les deux formes traitées “en miroir”.
Le second mouvement (Allegro) s’ouvre sur les deux groupes de cordes séparés. Il s’agit d’un scherzo en forme de sonate dans la tonalité d’Ut. L’emploi de sources musicales populaires stylisées accroît la scansion percussive de l’orchestre, qui est entraîné dans une danse échevelée. Les effets de rythmes croisés, le choc des sonorités abruptes produisent un effet d’autant plus saisissant que le piano se joint aux instruments à percussion.
Le troisième mouvement s’ouvre sur un adagio. Il s’agit d’une “musique nocturne”, le véritable cœur de l’œuvre. Les liens extra européens auxquels Bartók fait appel nous fascinent aujourd’hui encore : le gamelan balinais que l’on croit entendre, suggère des passerelles étonnantes avec les timbres de la tradition magyare. Bartok multiplie les combinaisons instrumentales alors inédites. À la déclamation d’un solo de xylophone énigmatique et angoissant répondent les étincelles de la harpe et du piano.
Le finale est en forme de rondo libre et symétrique au premier mouvement. Il rappelle une danse campagnarde joyeuse dont les couleurs du folklore hongrois se mélangent aux teintes roumaines et bulgares. Elles sont le prétexte à un “empilement” de techniques que Bartok maniait à la perfection : modale, tonale, atonale. La virtuosité y est éblouissante.
À lire :
« Béla Bartók » par Laetitia Le Guay (ed. Actes Sud, 2022).