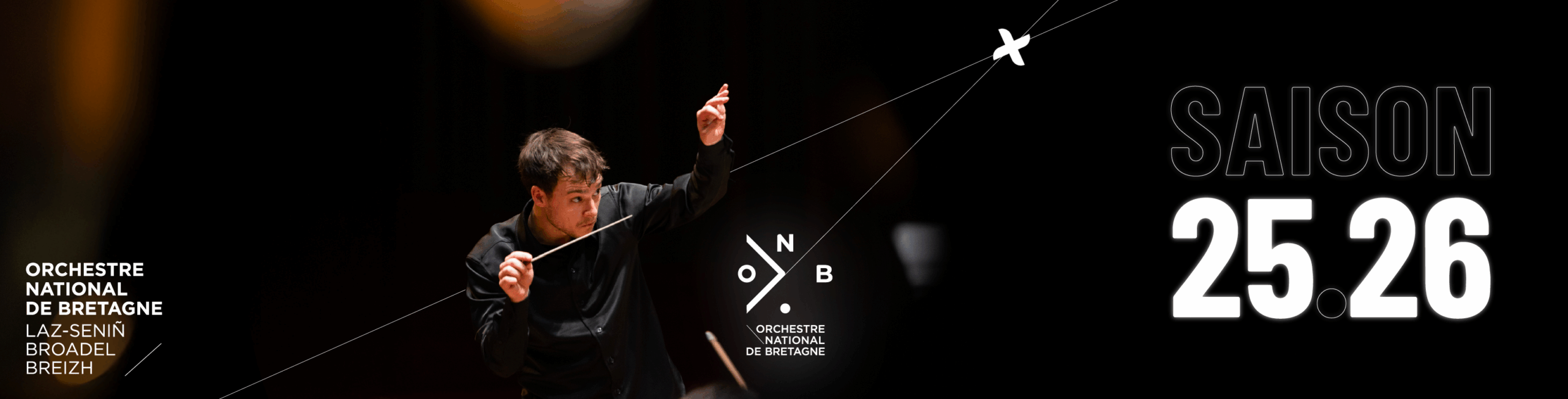Hommage à Pierre Boulez : carte blanche à Pascal Gallois – Interview de Pascal Gallois
Au cours de la seconde moitié du 20e siècle, Pierre Boulez a profondément marqué la vie musicale internationale notamment en tant que compositeur et chef d’orchestre.
À la tête du Münchener Kammerorchester (Orchestre de chambre de Munich), Pascal Gallois fut des années durant un bassoniste proche du compositeur. Il a choisi de lui rendre hommage. Ce concert s’inscrit dans le cadre d’une tournée du Münchener Kammerorchester, tournée soutenue par le Goethe Institut. Il témoigne du dialogue sans cesse nourri entre les compositeurs allemands et français, associant des œuvres du répertoire à deux créations.
Comment est né le partenariat avec le Münchener Kammerorchester – l’Orchestre de chambre de Munich – formation invitée au cœur de la saison de l’Orchestre National de Bretagne ?
Mon “ADN” est la création contemporaine ! Durant trente-cinq ans, j’ai été soliste à l’Ensemble Intercontemporain fondé par Pierre Boulez. En 2023, je me suis produit au Mozarteum de Salzbourg à la tête de l’Ensemble Altus. L’invitation provenait du compositeur Johannes Maria Staud qui enseigne à Salzbourg et collabore avec le Münchener Kammerorchester. Dans le cadre de l’hommage que nous rendons à Pierre Boulez, deux commandes ont été passées, l’une à Johannes Maria Staud et l’autre, à Philippe Manoury, l’un des compositeurs les plus proches de Pierre Boulez.
Ce programme est joué ce soir à l’Opéra de Rennes. Il sera redonné aux Musicales de Quiberon puis à la Maison de la Poésie, à Paris.
Quel regard portez-vous sur la personnalité de Pierre Boulez ?
Les médias français évoquent souvent la carrière du chef d’orchestre et la créativité intellectuelle de Pierre Boulez – et les allemands éprouvent une immense admiration pour l’artiste – mais on oublie sa capacité de partager avec les publics les plus divers. Il était né loin de la capitale, à Montbrison, et cela explique aussi sa facilité de se lier avec tout un chacun. De fait, il fut très proche de ses musiciens, tissant des rapports que je qualifierais de familiaux avec eux, à la manière d’un directeur d’une troupe de théâtre.
J’ai travaillé quotidiennement et durant plusieurs décennies avec Pierre Boulez qui m’a influencé dans mon approche de la musique. Il m’a aidé dans les liens que j’ai entretenus avec les grands musiciens depuis disparus tels que Karlheinz Stockhausen, Luciano Berio, Gÿorgy Ligeti, etc.
Avec du recul, je pense que la transmission me semble être le maître-mot de son action et, au fil du temps, de la mienne. C’est ainsi que j’ai créé, en 2015, les Musicales de Quiberon. Le programme était consacré à sa musique et à celle d’Arnold Schoenberg.
De quelle manière, les œuvres de ce programme se répondent-elles les unes les autres ?
Le point commun entre les quatre partitions est le répertoire de l’orchestre à cordes. Un répertoire qui n’est pas si grand que cela, mais d’une étonnante richesse. Il a pris toute sa valeur au 20e siècle avec des partitions majeures comme le Divertimento (1939) de Béla Bartók. Les pièces que nous entendons s’inscrivent dans une progression musicale logique et sensible à la fois. Disposer de vingt-deux instrumentistes à cordes au maximum sur scène, cela facilite une homogénéité de la texture sonore entre les pièces bien que celles-ci soient d’une esthétique différente les unes des autres.
L’autre aspect essentiel de cet hommage concerne le rapport que Boulez entretenait avec la culture germanique que nous plaçons, ici, en regard avec la musique française. Il faut imaginer de jeunes compositeurs d’une vingtaine d’année qui, au sortir de la guerre, se sont retrouvés en Allemagne pour créer un univers sonore nouveau. Il n’était pas question de faire une musique “nationaliste”. Dans sa pensée musicale, Boulez eut très tôt un rapport particulier avec la Seconde Ecole de Vienne (Arnold Schoenberg, Alban Berg et Anton Webern), ces compositeurs produisant selon les nazis, de la “musique dégénérée” (Entartete Musik). Le dialogue culturel incessant entre la France et l’Allemagne n’a jamais cessé, œuvrant à la réconciliation entre les deux peuples. Ce dialogue se révèle aussi bien dans la musique que dans le théâtre et la poésie.
Parlez-nous de Stachel, le titre de la pièce Johannes Maria Staud, compositeur autrichien né en 1974 et dont vous allez diriger la création…
Johannes Maria Staud tout comme Philippe Manoury n’ont pas perdu le souvenir du Divertimento de Béla Bartók, que j’évoquais. Pour autant, leurs esthétiques sont éloignées l’une de l’autre. Chez Staud, il y a une influence que je qualifierais « d’après une lecture de Bartók. » La partition d’un seul tenant comme un poème symphonique se déploie dans un scintillement sonore permanent avec des échanges entre les registres. L’influence de la musique spectrale, à la manière d’un Gérard Grisey y est perceptible. En lisant la partition, je remarque que les pupitres des contrebasses tiennent une place prépondérante. Leur technique de son est assez percussive, ce qui accentue une dimension de l’œuvre plus orchestrale que chambriste. J’ajouterais aussi un aspect narratif porté par un contrepoint que l’on retrouve, par exemple, chez le compositeur Michael Jarrell avec lequel Staud étudia.
Au cœur du concert, La Nuit Transfigurée impose sa puissance expressive :
« Deux être marchent dans un bois froid et dénudé ; La lune glisse avec eux, ils la regardent.
La lune glisse par-dessus les grands chênes. Aucun nuage ne ternit la limpidité du ciel
Vers lequel les branches dénudées se tendent… ». Les vers de La Femme et le monde (Weib und Welt) de Richard Dehmel ont fasciné Schoenberg. Que vous inspire cette musique ?
Elle révèle la richesse musicale de l’Europe centrale, son rapport avec la mélodie, ses liens avec l’esprit viennois dont se revendiquait Schoenberg. Jusque dans ses œuvres les plus avant-gardistes, il n’a jamais brisé le lien avec Vienne. C’est la raison pour laquelle La Nuit Transfigurée, pièce d’une si grande densité expressive provoque un tel plaisir à l’écoute. J’entends la préservation dissimulée du tempo de la valse, une respiration à laquelle Boulez était particulièrement sensible. Cette musique est une matière vivante possédant différents niveaux d’écoute plus ou moins complexes.
Pierre Boulez commente ainsi sa pièce Messagesquisse pour violoncelle solo et six violoncelles sur le nom de Paul Sacher : « Avec ce mot-valise, j’ai voulu offrir un témoignage de mon amitié envers Paul Sacher. L’œuvre renferme des messages qui lui sont adressés personnellement et sont codés de façon symbolique, comme dans une esquisse ». Avez-vous décodé les messages adressés par le compositeur ?
Je n’ai pas eu l’occasion de parler avec lui de sa pièce qui, en effet, possède des messages. Boulez aimait que l’on cherche par soi même. Il s’étonnait d’ailleurs que l’on découvre dans sa musique, des choses auxquelles il n’avait pas songé ! L’œuvre est née de la relation étroite entre le chef d’orchestre et mécène suisse Paul Sacher (1906-1999) et Mstislav Rostropovitch (1927-2007). Pour remercier son ami Paul Sacher qui l’avait accueilli lorsqu’il eut la possibilité de quitter l’URSS, le violoncelliste russe demanda à douze compositeurs d’écrire une œuvre qui célèbre, en 1976, le soixante-dixième anniversaire de Sacher. Witold Lutoslawski, Henri Dutilleux, Luciano Berio, Benjamin Britten, Pierre Boulez, entre autres, offrirent une partition nouvelle.
Le violoncelle solo joue d’une sonorité unique dont sont tirées toutes les sonorités dérivées. Les six violoncelles démultiplient ainsi les valeurs initiales. Six instruments et six lettres font référence au nom du dédicataire de la partition : S (mi bémol) A (la) C (do) H (si) E (mi) R (ré). Six séquences – ou variations – organisent la pièce. Elles prennent appui sur la sonorité première d’où émerge toujours le violoncelle solo avec une grande force expressive. Les contrastes sont d’autant plus marqués que les moyens utilisés paraissent modestes.
Philippe Manoury a élaboré Scales (gammes) sur un mode, des engendrements d’échelles, une gamme qui lui est propre. Comment se structure la partition ?
En effet, Philippe Manoury a voulu réaliser sa propre gamme à l’instar de Schoenberg. La construction est celle d’une masse sonore homogène sans la dimension percussive que l’on entend chez Staub. Manoury m’a dit avoir été profondément fasciné par les Métamorphoses de Richard Strauss (pour vingt-deux cordes également), sans qu’il y ait un lien esthétique entre lui et le compositeur de Zarathoustra ! Chez Manoury, les dialogues entre les pupitres sont intenses, portés par l’utilisation de l’ensemble de la masse rythmique. L’influence de Boulez me paraît marquante. Cela nécessite une grande précision dans la réalisation qui réclame beaucoup de technique.
Je note que trois passages sont notés ad libitum. Ils font appel à des éléments improvisés, des parties non mesurées. C’est un peu l’esprit de la musique de chambre et de l’écriture qui prévalait chez un Edgar Varèse et dans les premières partitions de Boulez. Dans ces passages, je ne dirigerai que de grandes sections. De fait, chaque instrumentiste est très sollicité.
A d’autres endroits de Scales, des parties jouées pianissimo sont d’une extrême finesse. Elles m’évoquent la musique spectrale. Pour conclure, je dirais que cette œuvre riche à l’écoute n’est nullement monolithique. Cela témoigne aussi du souci chez Manoury, de susciter l’attention du public.
Vous avez choisi d’achever le concert par l’Adagietto de la Symphonie n°5 de Gustav Mahler, partition achevée en 1901, la même année que celle du Pelléas et Mélisande d’Arnold Schoenberg. Boulez affirma que la musique de Mahler était pour lui, le “missing link” – le lien manquant – avec les compositeurs tels que Berg et de Webern…
Boulez vint assez tardivement à l’œuvre de Mahler. Le lien est en effet patent entre la Seconde Ecole de Vienne et le compositeur de l’Adagietto dont on sait la notoriété depuis le film Mort à Venise de Luchino Visconti. Ce quatrième mouvement de la Symphonie n°5 du musicien viennois est pour cordes seules et harpe. Il referme le concert par une page d’une grande émotion. N’est-ce pas aussi une manière émouvante de prendre congé de Boulez, un musicien qui fut un grand humaniste ?