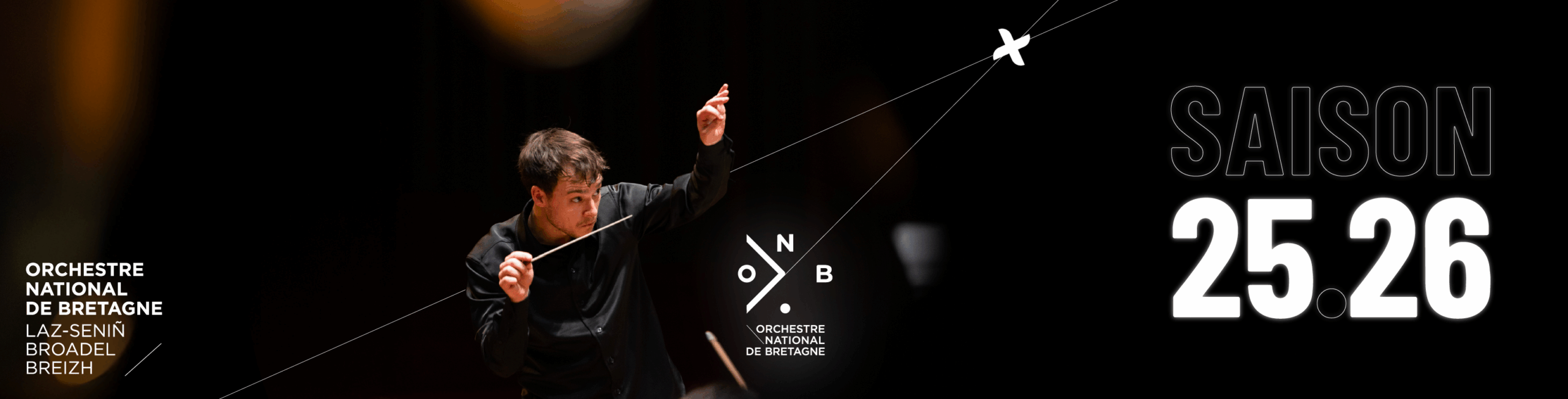Fugue à six voix (Ricercata, arrangement d’Anton Webern) extrait de Die Musikalische Opfer BWV 1079 – Jean-Sébastien BACH
Jean-Sébastien BACH
(1685-1750)
Fugue à six voix (Ricercata, arrangement d’Anton Webern) extrait de Die Musikalische Opfer BWV 1079
Date de composition : achèvement le 7 juillet 1747. Orchestration d’Anton Webern entre novembre 1934 et janvier 1935
Date de création de l’arrangement : 25 avril 1935 à Londres par l’Orchestre de la BBC dirigé par Anton Webern
Die Musikalische Opfer – L’Offrande Musicale – est née d’une prestigieuse rencontre. Le 7 mai 1747, à l’occasion d’une visite que rendit Bach à son fils Carl Philipp Emanuel, alors en poste à Berlin, Bach fut reçu par l’un de ses plus fervents admirateurs, le roi Frédéric II de Prusse, lui-même admirable flûtiste. Il lui demanda d’improviser sur l’un de ses pianofortes. Bach se lança dans une fugue à trois voix sur l’inoubliable thème en ut mineur (do, mi bémol, sol, la bémol).
De retour à Leipzig et pour remercier le souverain de son accueil, il composa une série de variations d’une prodigieuse inventivité, qu’il envoya au souverain, le 7 juillet 1747, en guise d’Offrande Musicale.
L’œuvre se compose de deux Ricercari – l’un des anciens noms de la fugue – neuf canons et une fugue ainsi que d’une Sonate en trio (flûte traversière, violon et continuo). Le premier des deux Ricercari reprend l’improvisation que joua Bach devant le roi. Sur le manuscrit, Bach se permet une facétie en rédigeant un acrostiche sur le mot R.I.C.E.R.C.A.R : Regis Iussu Cantio Et Reliqua Canonicae Arte Resoluta (Morceau réalisé par ordre du roi et autres morceaux résolus suivant l’art du canon). Quelques indications destinées au royal dédicataire parsèment la partition : « puisse la fortune du roi augmenter avec la valeur de ces notes », « puisse la gloire du roi grandir comme ces modulations », « cherchez et vous trouverez »…
L’Offrance Musicale nous apparaît comme une œuvre de synthèse. En effet, elle associe le contrepoint le plus savant à l’élégance du style de l’époque, sans oublier la nécessaire virtuosité.
Anton Webern releva le défi d’orchestrer la partition avec le souci de montrer une continuité historique entre l’œuvre de Bach et l’Ecole d’Arnold Schœnberg (Schœnberg, Alban Berg et Webern). Webern choisit une partition sans indication d’instrumentation et dont la puissance d’abstraction ne pouvait que le séduire. L’orchestration souligne la logique de la construction, multiplie les changements de timbres comme si ces derniers éclairaient la structure même de la partition. Cette quête de “pureté” n’est toutefois en rien un assèchement sonore. Le raffinement des couleurs, la douceur de la palette sonore appartiennent davantage à l’univers de la musique de chambre qu’à celui de l’orchestre symphonique.
À lire :
« Anton Webern » par Alain Galliari (Ed. Fayard, 2007).