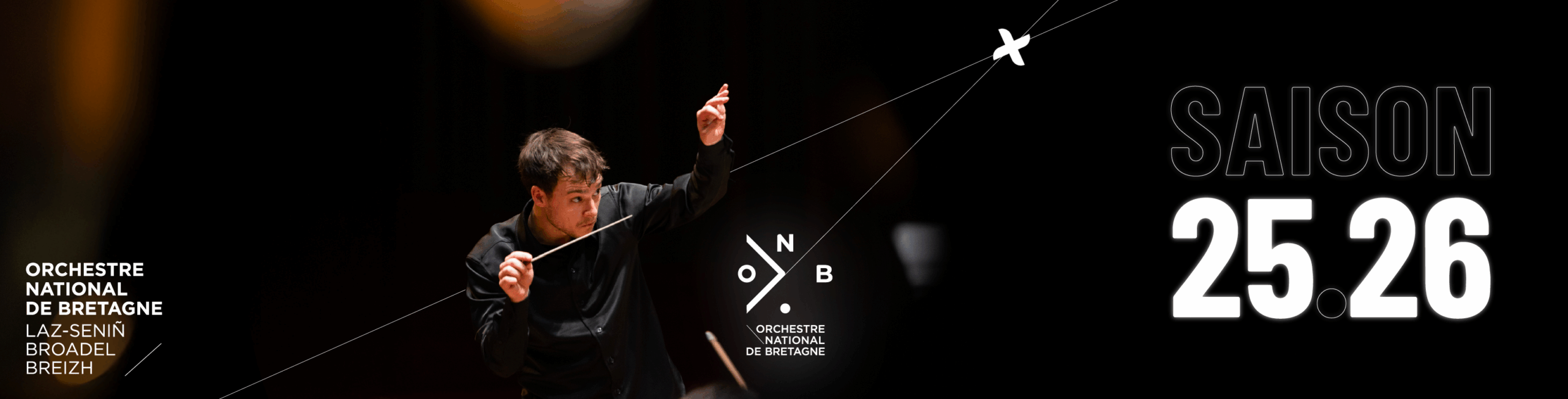Concerto pour alto et santour – Golfam Khayam
Golfam Khayam
(1983)
Concerto pour alto et santour
Date de composition : 2024, révision en 2025
Date de création : 6 avril 2024 à Francfort sur le Main par Muriel Razavi, alto, Kioomars Musayyebi, santour, le Bridges Kammerorchester dirigé par Nabil Shebata
La musique de la compositrice iranienne Golfam Khayam est interprétée par quelques-unes des plus grandes formations de la scène internationale. Des commandes ont été passées à cette artiste lauréate de nombreux concours, bourses et prix. Elle se passionne pour les liens si fructueux entre les traditions et les cultures, associant les éléments du patrimoine musical persan aux formes classiques européennes.
Vous avez été nommée compositrice en résidence à l’Orchestre national de Bretagne. Qu’est-ce que cela représente pour vous ?
C’est d’abord un honneur de travailler avec un orchestre aussi ouvert sur le monde et attentif au développement de projets interculturels. L’art est un prodigieux vecteur de communication entre les Hommes et cela me paraît d’autant plus essentiel dans les temps dramatiques que nous connaissons.
Comment est née votre double concerto ?
Il s’agit d’une commande du Bridges-Kammerorchester [cet orchestre basé en Allemagne et fondé en 2019 réunit des musiciens d’une quinzaine de nationalités différentes. Ils composent et arrangent des morceaux de musique aux origines culturelles les plus diverses, ndlr.]. Composer un double concerto pour santour et alto représentait un grand défi car il s’agissait de faire dialoguer deux instruments provenant de cultures éloignées l’une de l’autre, mais dont je sentais une étonnante complémentarité. Dans la première version du concerto, qui fut donnée par le Bridges-Kammerorchester, je disposais d’instruments orientaux tels que le oud, le ney et le tombak. Pour ce concert, il n’y a que le santour et les instruments de l’orchestre habituel. Pour autant, la version modifiée que nous entendons a préservé les couleurs orientales originelles.
Dans la musique occidentale et tout particuièrement dans les pays de l’Europe de l’Est, l’alto est l’instrument de la confidence, de l’intimité. Est-ce que l’on retrouve cette dimension dans le jeu et le répertoire du santour ?
Absolument. J’ai beaucoup composé pour l’alto qui est précisément cette voix intimiste, ma voix puisque ma tessiture est celle de l’alto ! De son côté, le santour est, dans la musique persane, à la fois soliste et aussi acompagnateur notamment pour les chanteurs. Son rôle est polyvalent. Il offre aussi bien des harmonies très fines, qu’un volume sonore puissant et percussif.
Dans votre musique et pas seulement dans ce concerto, on ressent une pulsation intense. Elle porte à la fois les deux solistes, mais aussi l’orchestre. De fait, votre pièce apparaît éminnement narrative…
Dans le concerto, la pulsation du santour est essentielle dès le premier mouvement. C’est une pulsation que je qualifierais de “résistante”, au sens général du terme. La partition est d’ailleurs basée sur le concept de « résistance et résilience ». Un concept approprié en regard de la culture persane méconnue en Occident, mais aussi à titre plus personnel car lorsque j’ai reçu cette commande, mon enfant n’était âgé que de quelques mois. Je devais garder toute ma force pour continuer à être mère, compositrice et tout cela dans un monde d’une grande brutalité. D’autres éléments m’ont influencé. Je songe notamment à une poésie d’Ahmad Chamlou (1925-2000), l’un des grands poètes iraniens. Il évoque l’esprit de résistance et cela m’a profondément inspiré dans le premier mouvement : « Nous avons enduré la solitude et le silence, et [nos cœurs] battent encore dans les profondeurs des cendres… »
Le deuxième mouvement, lent, s’ouvre par une sorte de murmure. Les bruits de la nature surgissent et l’alto porte le chant qui s’échange ensuite entre les deux solistes. C’est une atmosphère presque immobile, comme une plainte, qui devient lyrique aux cordes de l’orchestre…
Ce mouvement est basé sur une forme commune chez les musiciens persans et qui s’intitule djavab avaz. Elle pourrait se traduire par réponse et chant. La correspondance dans le langage musical occidental serait le ricercar et la fantaisie. J’utilise régulièrement dans ma musique, ce système de questions / réponses avec un contrepoint élaboré, mais aussi une certaine improvisation. Certes, l’œuvre étant destinée à un orchestre de culture occidentale, il n’y a pas d’improvisation puisque tout est, en principe, écrit. Il s’agit simplement de donner l’illusion… Toutefois, dans une petite partie du mouvement, le santour improvise et sur un signe, l’orchestre reprend. Le soliste a une partie chargée sur le plan ornemental, comme s’il devait créer un tapis sonore.
Directement enchaîné, le troisième mouvement a l’allure d’une danse. Quelles en seraient les origines ?
Je me suis inspirée d’une danse provenant du Balouchistan, l’une des provinces du Pakistan, au sud-est de l’Iran. La culture musicale de cette région est puissante et unique. La musique, par exemple, accompagne divers rituels avec des pulsations répétitives. La danse que j’emprunte rend hommage à une personne qui fut assassinée et que l’on voit danser quelques temps auparavant dans une fête comme si cet homme était sur une autre planète. La mélodie de cette sorte de danse de mort m’est restée en mémoire.
Vos œuvres paraissent associer de multiples influences, entre la mémoire de musiques traditionnelles, mais aussi d’esthétiques contemporaines les plus variées. Quelles seraient les sources de votre écriture ?
Ma musique combine en effet diverses influences. Tout d’abord, celle de la tradition que j’ai découverte au sortir de l’adolescence et que j’intègre dans ma musique. Ensuite, je n’ai pas d’écoles précises. Je pourrais vous citer les grands compositeurs “classiques”, de la Renaissance à la création contemporaine. Au 20e siècle, il y a bien sûr Maurice Ravel, Béla Bartok, Jean Sibelius, Olivier Messiaen, Benjamin Britten, Witold Lutoslawski, György Ligeti, Kaija Saariaho, Tristan Murail… Ma liste n’est, bien entendu, pas exhaustive !