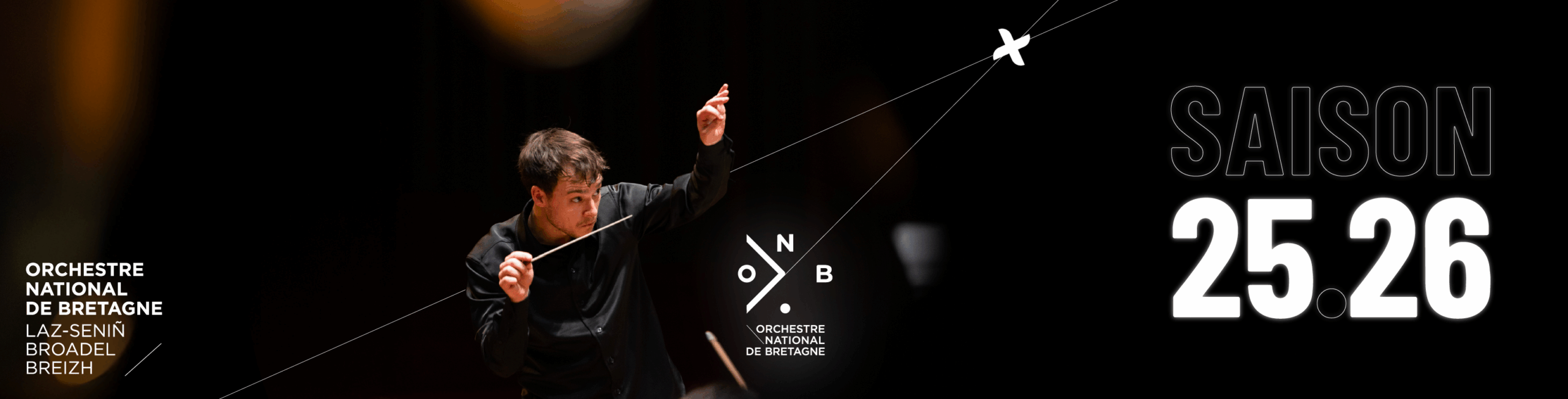Concert Românesc (Concerto Roumain) – György Ligeti
György Ligeti
(1923-2006)
Concert Românesc (Concerto Roumain)
- Andantino
- Allegro vivace
- Adagio ma non troppo
- Molto vivace
Date de composition : 1951
Date de création : 21 août 1971 par le Peninsula Music Festival de Fish Creek (Wisconsin, USA) sous la direction de Thor Johnson
L’année 1956 fut pour beaucoup d’intellectuels et d’artistes Hongrois une année maudite. Après avoir perdu une partie de sa famille dans les camps de concentration nazis, Ligeti fut confronté à la répression de ce fameux novembre. Le mois suivant, sa fuite rocambolesque s’acheva à Vienne. L’ancien élève de Ferenc Farkas et de Sandor Veress au Conservatoire de Budapest commença alors une nouvelle carrière musicale, rejoignant l’avant-garde occidentale à Donauschingen et aux studios de la WDR de Cologne. En Hongrie, déjà, il avait développé une approche artistique originale. Ses premières œuvres avaient été marquées par les recherches folkloriques qu’il avait entreprises en Roumanie à la fin des années quarante. Il avait exploré le domaine de la couleur sonore, du timbre, produisant des partitions largement influencées par l’écriture de Béla Bartók et d’Alban Berg. Installé à Vienne, il s’immergea aussitôt dans la production sérielle et les esthétiques dominantes du début des années soixante. Rapidement, son œuvre allait connaître une notorité internationale.
Il faut entreprendre un retour en arrière et, plus précisément en 1951 pour goûter aux exquises dissonances du Concerto roumain destiné à un orchestre à la nomenclature dite “Mozart”. La partition se divise en quatre parties qui équilibrent avec une subtilité extraordinaire, les solos de cordes et de bois.
Ligeti qui vécut en Transylvanie et au sein de la communauté hongroise de cette région rend hommage à la musique folklorique roumaine. À la suite de Béla Bartók et de Zoltan Kodaly qui s’étaient rendus, quelques décennies plus tôt, dans les villages les plus reculés des pays du Danube afin de recueillir sur des rouleaux de cire, les chants des paysans pour s’en inspirer dans nombre de leurs œuvres, Ligeti choisit, à son tour, ce qu’il nomma une « musique folklorique authentique ». Il le fit discrètement, en allant à l’Institut du folklore de Bucarest. Ne pouvant sortir les partitions, il les transcrivit d’oreille… En effet, le régime communiste hongrois avait interdit d’exploiter cette musique “sale” et le musicien se savait surveillé par l’Union des Compositeurs sans laquelle rien ne pouvait être diffusé. Cela explique que le Concerto roumain ait été donné très tardivement et enregistré un demi-siècle après sa composition. Ses quelques dissonances la condamnèrent sans appel : « Mon Concerto roumain offre, dans le quatrième mouvement, un passage dans lequel apparaît un fa dièse dans un contexte de fa majeur. Il n’en fallait pas plus aux apparatchiks de la culture pour interdire tout l’œuvre […]. Que des plaisanteries tonales aussi anodines puissent être dénoncées comme « une atteinte à la sécurité de l’État » semble proprement impensable à un auditeur d’aujourd’hui » écrivit Ligeti dans L’Atelier du compositeur. Ecrit autobiographiques (éditions Contrechamps).
À lire :
« György Ligeti » par Karol Beffa (ed. Fayard, 2016)